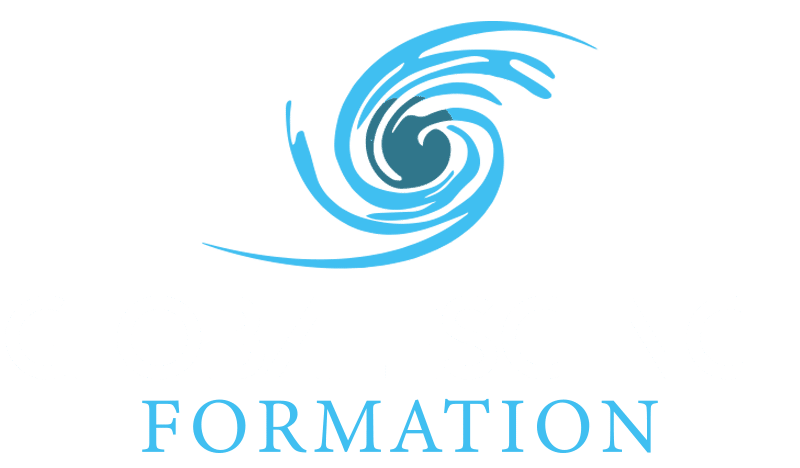Spécialiste de la Formation en Hypnose thérapeutique
dédiée au personnel de santé
Suivre un
parcours complet
Intégrer les ressources de l’hypnose dans votre pratique pour une réponse adaptée et personnalisée aux besoins de vos patients
Compléter
votre pratique
Approfondissez vos connaissances avec des ateliers autour de l’hypnose ou des formations complémentaires
Enrichir les pratiques médicales grâce à l’hypnose : un plus pour le patient comme pour le thérapeute
” Depuis plus de 12 ans, nous avons développé un parcours complet de formation à l’hypnose permettant de revisiter et d’enrichir en profondeur notre posture de soignant. Nous avons à cœur de transmettre nos années de recherches et de pratique terrain en vous proposant une formation complète basée sur la mise en pratique. Votre approche thérapeutique s’en trouvera profondément transformée. “


Formations pour les soignants alliant théorie et pratique
De plus en plus de soignants comprennent l’intérêt de l’hypnose dans leur pratique quotidienne, pour eux comme pour leurs patients. Porté par un duo à l’avant-garde de l’hypnose, Globalescence s’appuie sur une équipe de professionnels de la santé, experts de l’hypnose et de pratiques complémentaires.
Notre expertise et notre engagement nous permettent de proposer des formations spécialisées riches et vivantes reconnues et plébiscitées par les organismes comme par les stagiaires.
En quoi l’hypnose va-t-elle changer ma pratique ?
À l’issue de nos formations en hypnose, nos stagiaires relèvent des changements importants dans leur approche professionnelle.
En s’attachant à mettre l’hypnose au service de la clinique, nous apprenons aux soignants à décrypter les situations cliniques pour poser une intention claire, un objectif, à la séance d’hypnose. Un atout précieux pour repenser sa fonction de soignant.
Faciliter la relation patient dans toutes les situations
Approfondir l’approche clinique
Remettre le patient au coeur de son parcours de soin
Réinvestir sa fonction de soignant
Une formation au plus proche des évolutions scientifiques
Jean-Pierre Alibeu, cofondateur de Globalescence, anesthésiste-réanimateur et médecin de la douleur de formation, a toujours eu à cœur de moderniser sa pratique de soins en l’enrichissant des données actualisées de la science.
Il publie régulièrement autour de thématique telles que la douleur, la neurostimulation et l’hypnose qui peut être considérée comme une forme de neurostimulation.
Ses apports scientifiques sont très appréciés par la communauté médicale et par nos élèves qui y trouvent les bases d’une appropriation de l’hypnose.

Formations en hypnose certifiée Qualiopi
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante
ACTIONS DE FORMATION
Prises en charge par le FIFPL en cours d’agrément
Formations en hypnose certifiée Qualiopi
Ils nous font confiance


FAQ
Oui, si vous souhaitez accéder à nos formations complémentaires en hypnose, vous devez simplement justifier d’une formation initiale en hypnose clinique, même de la part d’un autre organisme.
Les formations complémentaires liées à la psychologie (communication thérapeutique, psychopathologie, etc.) sont accessibles sans autre pré requis qu’être personnel de santé.
Bien sûr, chacun se fera son idée sur la question en fonction de l’objectif visé. Nous faisons en sorte que nos formations en hypnose à destination des soignants allient la théorie à la pratique. Nous privilégions des petits groupes en présentiel afin de rendre la pratique concrète et évidente, et ainsi, faciliter sa mise en application rapide dans la pratique professionnelle.
Nos formations s’adressent exclusivement aux professionnels de santé : médecins, infirmières, sages-femmes, aides-soignantes, psychologues, dentistes, kinésithérapeutes, manipulateurs en radiologie et donc tous les candidats possédant un diplôme en santé.
Globalescence est certifié Qualiopi, référencé Datadock et donc validé par tous les organismes finançant les formations en santé. Nous pouvons à votre demande établir une convention avec votre organisme. Comme mentionné dans les fiches, certaines formations sont prises en charge par le FIFPL ou le CPF. Des demandes d’agréments complémentaires sont en cours, n’hésitez pas à nous contacter.
Globalescence formations intervient exclusivement à destination des personnels de santé. Afin de diffuser l’hypnose au plus grand nombre en préservant la qualité de nos formations, nous avons créé l’association « Libérer le savoir » à destination du grand public.
Tous les formateurs de Globalescence sont des professionnels pratiquant l’hypnose thérapeutique dans leurs domaines de compétences respectifs. Retrouvez-les dans notre page ÉQUIPE (lien)
Les formateurs habituels de Globalescence sont tous aguerris à la pratique de l’hypnose thérapeutique dans leur champ de compétence. Il peut arriver parfois que d’autres intervenants ponctuels, sélectionnés pour leur compétence spécifique, soient sollicités pour aborder un sujet particulier.
En France, les formations « validantes » sont les diplômes de spécialités, les capacités, les DIU. En hypnose, il n’existe aucun diplôme au plein sens du terme, ni aucune formation en hypnose reconnue par l’Etat. Les DU et autres formations réalisées dans le cadre de la charte éthique (réservées aux soignants) sont donc des certificats de formation qui ont une valeur propre en fonction de leur qualité.
Le règlement est à envoyer à Globalescence, 1 rue du petit Bicêtre, 77170 Brie-Comte-Robert. Merci d’établir vos chèques à l’ordre de Globalescence.


Témoignages